par
Pepe Escobar. Traduit par
Fausto Giudice, Tlaxcala
Bologne-Aux
premières heures du 2 novembre 1975, à l'Idroscalo, une banlieue
pourrie de Rome, près d'Ostie, était retrouvé le corps de Pier Paolo
Pasolini, alors âgé de 53 ans, qui avait été tabassé à mort et écrasé
par sa propre Alfa Romeo. Ainsi disparaissait une locomotive
intellectuelle et l'un des plus grands cinéastes des années 60 et 70.
Il aurait été difficile d'imaginer un mélange moderne plus surprenant
et poignant de tragédie grecque et d'iconographie de la Renaissance :
dans une mise en scène tout droit sortie d'un film de Pasolini, l'auteur
lui-même se retrouvait immolé tout comme le personnage principal de Mamma Roma (1962), gisant en prison à la manière du Christ mort d'Andrea Mantegna.
Il aurait pu s'agir d'un rendez-vous
gay ayant très mal tourné : un petit voyou de 17 ans fut accusé du
meurtre, mais le jeune homme était aussi lié à des néofascistes
italiens. La vérité n'a jamais été établie. Ce qui est apparu, c'est que
Pasolini avait été tué par la "nouvelle Italie" – les retombées d'une
nouvelle révolution capitaliste.

"Ceux qui sont destinés à être morts"
 Pour
les Italiens éduqués, il était essentiellement un poète (ce qui, il y a
quelques décennies, était un sacré compliment…). Dans son œuvre
maîtresse, Les Cendres de Gramsci (1952), Pasolini établit un
parallèle frappant, en termes d'aspiration à un idéal héroïque, entre
Gramsci et Shelley, qui se trouve être enterré dans le même cimetière
romain. Ce qu'on peut appeler de la justice poétique.
Pour
les Italiens éduqués, il était essentiellement un poète (ce qui, il y a
quelques décennies, était un sacré compliment…). Dans son œuvre
maîtresse, Les Cendres de Gramsci (1952), Pasolini établit un
parallèle frappant, en termes d'aspiration à un idéal héroïque, entre
Gramsci et Shelley, qui se trouve être enterré dans le même cimetière
romain. Ce qu'on peut appeler de la justice poétique.Puis, sans effort, il passa du mot à l'image. Le jeune Martin Scorsese fut estomaqué quand il vit pour la première fois Accattone (1961); pour ne pas parler du jeune Bernardo Bertolucci, qui se trouva apprendre le B.A.-BA du métier comme caméraman de Pasolini. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sans Pasolini, un Scorsese, un Bertolucci, ou d'ailleurs un Fassbinder, un Abel Ferrara et un tas d'autres n'auraient pas existé.
Et particulièrement aujourd'hui, alors que nous marinons dans cette sordide foire aux vanités 24 heures sur 24, il est impossible de ne pas éprouver de sympathie pour la méthode Pasolini, qui oscille entre une critique sulfurique de la bourgeoisie (comme dans Teorema et Porcile), le refuge des classiques (sa phase tragédie grecque) et la fascinante "Trilogie de vie" médiévale : les adaptations du Décaméron (1971), des Contes de Canterbury (1972) et des Mille et Une Nuits (1974).
Il n'est pas étonnant que Pasolini ait choisi de fuir l'Italie corrompue et décadente pour aller filmer dans le monde en développement, de la Cappadoce turque pour Médée au Yémen pour les Nuits. Plus tard, Bertolucci fera la même chose, filmant au Maroc (Un thé au Sahara), au Népal (Little Buddha) et en Chine (Le Dernier Empereur, son formidable succès hollywoodien).
Puis il y eut Salò ou les 120 Journées de Sodome, le dernier film, torturé et ravageur, de Pasolini, sorti seulement quelques mois après sa mort, interdit pendant des années dans des douzaines de pays, et impitoyable dans son extrapolation du flirt italien et occidental avec le fascisme.
De 1973 à 1975, Pasolini écrivit une série de chroniques pour le Corriere della Sera, publiées sous le titre Écrits corsaires en 1975 puis, à titre posthume sous le titre Lettres luthériennes en 1976. Leur thème récurrent était la "mutation anthropologique" de l'Italie moderne, qui peut être vue comme un microcosme de la plus grande partie de l'Occident.
J'appartiens à une génération dans laquelle beaucoup ont été absolument obnubilés par Pasolini à
 l'écran et sur le papier. À cette époque, il était évident que ces
chroniques étaient des tirs de mortiers d'un intellectuel extrêmement
acéré mais totalement isolé. À les relire aujourd'hui, elles ont un ton
et un contenu prophétique.
l'écran et sur le papier. À cette époque, il était évident que ces
chroniques étaient des tirs de mortiers d'un intellectuel extrêmement
acéré mais totalement isolé. À les relire aujourd'hui, elles ont un ton
et un contenu prophétique.Examinant la dichotomie entre garçons bourgeois et prolétaires – comme celle entre le Nord et le Sud de l'Italie -, Pasolini tombe sur une nouvelle catégorie, "difficile à décrire (parce que personne ne l'avait fait jusqu'alors)" et pour laquelle il ne trouvait "aucun précédent linguistique et terminologique". C'était "ceux destinés à être morts". Et de fait l'un d'eux pourrait avoir été son meurtrier à l'Idroscalo.
Selon Pasolini, ces nouveaux spécimens étaient ceux qui, jusqu'au milieu des années 50, auraient été victimes de la mortalité infantile. La science intervint et les sauva de la mort physique. Ils sont donc des survivants, "et il y a dans leur vie quelque chose de contro natura". Donc, argumente Pasolini, si les fils nés aujourd'hui ne sont pas à priori "bénis", ceux qui sont nés "en excédent" sont définitivement "réprouvés".
Bref, pour Pasolini, les nouvelles générations, ayant le sentiment de ne pas êtres vraiment bienvenues, et se sentant coupables pour cela, sont "infiniment plus fragiles, brutales, tristes, pâles et mal dans leur peau que toutes celles qui les ont précédées". Elles sont déprimées ou agressives. Et "rien ne parvient à effacer l'ombre qu'une anomalie inconnue projette sur leur vie". De nos jours, cette interprétation peut permettre de comprendre la jeunesse musulmane aliénée, transfrontalière qui, portée par le désespoir, rejoint le Jihad.
En même temps, toujours selon Pasolini, ce sentiment inconscient d'être fondamentalement bons à jeter ne fait qu'alimenter chez "ceux qui sont destinés à être morts" l'aspiration à la normalité, "l'adhésion totale, sans réserve à la horde, le désir de ne pas apparaître comme distinct ou différent". Il "montrent" donc "comment vivre de manière conformiste avec agressivité". Ils enseignent la "renonciation", une "tendance à être malheureux", la "rhétorique de la méchanceté" et la brutalité. Et les brutes deviennent les champions de la mode et du comportement (ici Pasolini préfigurait déjà les punks de l'Angleterre de 1976).
Celui qui se décrivait lui-même comme un "vieux bourgeois rationaliste et idéaliste" allait au-delà de ces réflexions sur la génération "no future". Il empilait, entre autres désastres, la destruction urbaine de l'Italie, la responsabilité de la "dégradation anthropologique" de l'Italie, les terribles conditions des hôpitaux, des écoles et des services publics, l'explosion sauvage de la culture de masse et des mass media, la "bêtise criminelle" de la télévision, le "poids moral" de ceux qui ont gouverné l'Italie de 1945 à 1975, c'est-à-dire les démocrates-chrétiens soutenus par les USA.
Il dessina habilement les contours du "cynisme de la nouvelle révolution capitaliste-le première véritable révolution de droite". Une telle révolution impliquait, selon lui "d'un point de vue anthropologique – en termes de fondation d'une nouvelle 'culture' – des hommes sans lien avec le passé, vivant dans 'l'impondérabilité'. Si bien que la seule attente existentielle possible est le consumérisme et la satisfaction d'envies hédonistes". C'est la mordante "société du spectacle" de Guy Debord des années 1960 étendue au sombre horizon du "rêve est fini" des années 1970.
À l'époque, c'était là du matériel radioactif. Pasolini ne faisait pas de prisonniers : si la consumérisme avait sorti l'Italie de la pauvreté "pour la gratifier avec un bien-être" et une certaine culture non-populaire, ce résultat humiliant avait été obtenu "en singeant la petite bourgeoisie, la stupide école obligatoire et la télévision criminelle". Pasolini avait coutume de tourner en dérision la bourgeoisie italienne comme "la plus ignorante d'Europe" (en cela, il se trompait : pour ça, la bourgeoise espagnole décroche la timbale).
Puis émergea un nouveau mode de production culturelle – construit sur le "génocide des cultures précédentes" – ainsi qu'une nouvelle espèce bourgeoise. Si Pasolini avait survécu, il aurait pu voir celle-ci dans sa splendeur, sous la forme d'Homo Berlusconis.
La Grande Beauté n'est plus
 Le
cœur consumériste des ténèbres - "l'horreur, l'horreur" – déjà
prophétisé et détaillé par Pasolini au milieu des années 1970 vient
d'être dépeint avec tout son bling-bling sordide par le cinéaste
napolitain Paolo Sorrentino, né quand Pasolini, pour ne pas parler de Fellini, était déjà au sommet de son art. La Grande Bellezza
("La Grande Beauté") – qui vient juste de remporter les Globes d'Or
comme meilleur film étranger (aux USA) et devrait aussi remporter un
Oscar– aurait été inconcevable sans La Dolce Vita de Fellini (dont il est une coda inavouée) et la critique pasolinienne de la "nouvelle Italie".
Le
cœur consumériste des ténèbres - "l'horreur, l'horreur" – déjà
prophétisé et détaillé par Pasolini au milieu des années 1970 vient
d'être dépeint avec tout son bling-bling sordide par le cinéaste
napolitain Paolo Sorrentino, né quand Pasolini, pour ne pas parler de Fellini, était déjà au sommet de son art. La Grande Bellezza
("La Grande Beauté") – qui vient juste de remporter les Globes d'Or
comme meilleur film étranger (aux USA) et devrait aussi remporter un
Oscar– aurait été inconcevable sans La Dolce Vita de Fellini (dont il est une coda inavouée) et la critique pasolinienne de la "nouvelle Italie".Pasolini et Fellini étaient d'ailleurs issus de la même tradition intellectuelle d'Émilie-Romagne (Pasolini de Bologne, Fellini de Rimini, tout comme Bertolucci de Parme. Au début des années 1960, Fellini disait en blaguant à son ami et encore apprenti Pasolini qu'il n'était pas équipé pour al critique. Fellini était toujours pure émotion, alors que Pasolini - comme Bertolucci -, c'était de l'émotion modulée par l'intellect.
Le film étonnant de Sorrentino – une équipée sauvage dans les méandres de l'Italie berlusconienne – est une Dolce Vita qui aurait tourné à l'aigre. Comment ne pas éprouver de l'empathie pour un Marcello (Mastroianni) âgé de 65 ans (et joué par l'époustouflant Toni Servillo), souffrant de la crampe de l'écrivain tout en surfant sur sa réputation de roi de la nuit romaine. Comme le grand Ezra Pound – qui aimait profondément l'Italie – l'avait aussi prophétisé, une production sinistre de camelote nous a conduits à la débilité berlusconienne, où – selon un personnage – tout le monde "a oublié la culture et l'art" et l'ancien sommet de civilisation qu'était l'Italie a fini par ne plus être connue que pour "la mode et la pizza".
C'était exactement ce que nous disait Pasolini il y a presque quatre décennies – avant qu'une manifestation étrange et effrayante de cette abjection ne le réduise au silence. Sa mort, en fin de compte, a prouvé - avant la lettre – son théorème : il a malheureusement toujours eu raison. À en mourir.
Portraits de Pier Paolo Pasolini par David Parenti











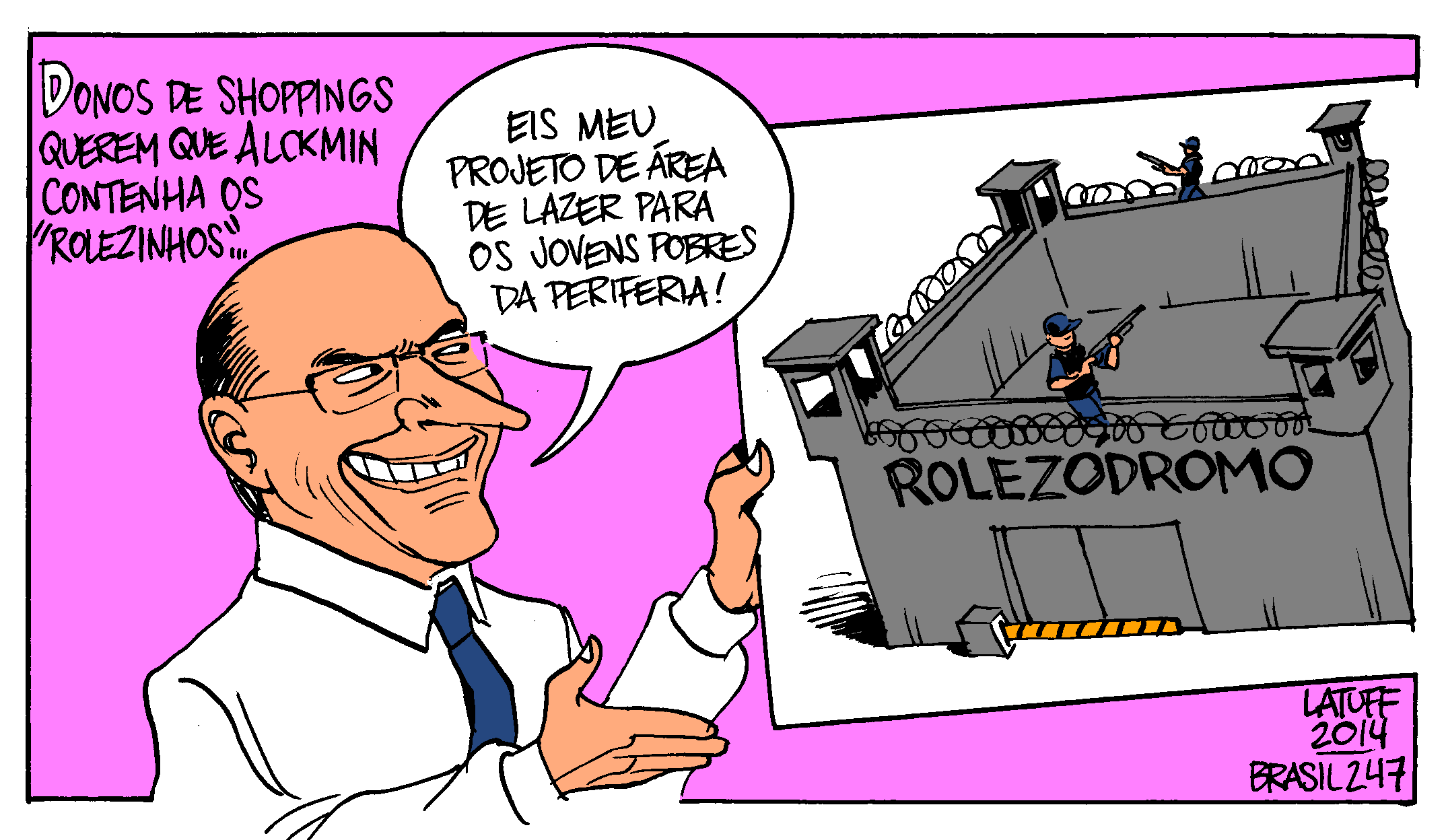





 Considéré
comme l’un des majeurs poètes contemporains d’Amérique latine, Juan
Gelman était né en 1930 à Villa Crespo, un quartier de Buenos Aires,
troisième enfant de José et Paulina, deux immigrants juifs de Russie.
Il apprend à lire à l’âge de trois ans et passe son enfance à faire du
vélo, jouer au foot et à lire. Dans sa jeunesse il fait partie de
divers groupes et mouvements littéraires, dont „El pan duro“ (le Pain
dur), qui édite son premier livre, “Violín y otras cuestiones”.
Considéré
comme l’un des majeurs poètes contemporains d’Amérique latine, Juan
Gelman était né en 1930 à Villa Crespo, un quartier de Buenos Aires,
troisième enfant de José et Paulina, deux immigrants juifs de Russie.
Il apprend à lire à l’âge de trois ans et passe son enfance à faire du
vélo, jouer au foot et à lire. Dans sa jeunesse il fait partie de
divers groupes et mouvements littéraires, dont „El pan duro“ (le Pain
dur), qui édite son premier livre, “Violín y otras cuestiones”.  Sous
la dictature son fils Marcelo Ariel et sa belle-fille María Claudia
García Irureta Goyena de Gelman sont enlevés par les forces de
répression. Marcelo meurt sous la torture et María Claudia est exécutée
en Uruguay après avoir accouché de sa fille, par un groupe de
tortionnaires dirigés par l’Uruguayen Ricardo José Medina Blanco, alias
Le Lapin. Une des nombreuses pages sombres de l’Opération Condor
montée par la CIA contre tous ceux qui furent identifiés comme ennemis
par les dictatures du Cône Sud (Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay,
Bolivie).
Sous
la dictature son fils Marcelo Ariel et sa belle-fille María Claudia
García Irureta Goyena de Gelman sont enlevés par les forces de
répression. Marcelo meurt sous la torture et María Claudia est exécutée
en Uruguay après avoir accouché de sa fille, par un groupe de
tortionnaires dirigés par l’Uruguayen Ricardo José Medina Blanco, alias
Le Lapin. Une des nombreuses pages sombres de l’Opération Condor
montée par la CIA contre tous ceux qui furent identifiés comme ennemis
par les dictatures du Cône Sud (Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay,
Bolivie).



